02. Couvent bénédictin Saint-Jean à Müstair
Page 1 sur 1
 02. Couvent bénédictin Saint-Jean à Müstair
02. Couvent bénédictin Saint-Jean à Müstair
2. Couvent bénédictin Saint-Jean à Müstair (inscrit en 1983)
Fondé par Charlemagne vers l’an 800 dans une vallée des Grisons, ce bien est resté authentiquement médiéval. L’église est l’une des rares constructions de l’époque carolingienne à être parvenue jusqu’à nous presque intacte. Ses fresques du IXe siècle, les plus importantes qui nous restent du haut Moyen Âge, et ses peintures des XIIe et XIIIe siècles témoignent de l’apogée du christianisme médiéval. L’imposante tour de la Planta, construite en 957, est le monument le plus ancien de la région alpine. La vie monacale continue de marquer ce lieu de culture et de recherche archéologique.
Source : https://www.unesco.ch/
Fondé par Charlemagne vers l’an 800 dans une vallée des Grisons, ce bien est resté authentiquement médiéval. L’église est l’une des rares constructions de l’époque carolingienne à être parvenue jusqu’à nous presque intacte. Ses fresques du IXe siècle, les plus importantes qui nous restent du haut Moyen Âge, et ses peintures des XIIe et XIIIe siècles témoignent de l’apogée du christianisme médiéval. L’imposante tour de la Planta, construite en 957, est le monument le plus ancien de la région alpine. La vie monacale continue de marquer ce lieu de culture et de recherche archéologique.
Source : https://www.unesco.ch/
Dernière édition par ADMIN le Lun 18 Sep - 20:46, édité 3 fois

ADMIN
 Unesco : Convent bénédictin Saint-Jean à Müstair
Unesco : Convent bénédictin Saint-Jean à Müstair
Selon la légende, le couvent du Val Müstair dans les Grisons a été fondé au VIIIe siècle par Charlemagne et n’a jamais été entièrement détruit. Bien conservé, il révèle aujourd’hui des styles architecturaux de plusieurs époques et renferme des trésors accumulés sur une douzaine de siècles. Ce qui a été déterminant pour son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, ce sont les peintures murales de l’église conventuelle. Il s’agit du cycle de fresques le plus important et le mieux conservé du Haut Moyen Âge. Aujourd’hui encore, le couvent continue d’abriter des bénédictines qui perpétuent un rythme basé sur «ora et labora». Vie monacale, activité culturelle, musée, recherche et restauration se fondent ici en un tout unique.
Musée
Le musée monastique se situe dans la tour Planta, une tour d’habitation fortifiée plus que millénaire. Accueillis au son d’une cloche liturgique du XIIe siècle, vous serez entraînés dans un voyage au cœur des 1200 ans d’histoire du monastère. Les bénédictines de Müstair vous offrent un aperçu de leurs lieux de vie ainsi que de leur quotidien hier et aujourd’hui.
Visite du musée
La visite du musée débute dans le cloître roman, et se poursuit dans l’imposante cave de la tour Planta puis dans les trois étages supérieurs, qui forment un véritable "monastère dans le monastère". Vous parcourrez des espaces d’habitation et de travail, de modestes cellules comme des lieux d’apparat ou de prière, de même que la chambre "von Hohenbalken", une élégante pièce de réception baroque. Vous découvrirez les dernières trouvailles archéologiques, des objets d’art et d’histoire ainsi que différents trésors issus des collections du monastère.
Visite guidée
A l’origine, l’usage de l’église était réservé à la communauté monastique. Ce n’est qu’au XVIe siècle, suite aux troubles de la Réforme, qu’elle fut ouverte à tous en tant qu’église paroissiale. En été, des offices y ont lieu régulièrement. L’église de Saint-Jean à Müstair abrite le plus grand et le mieux conservé des cycles de fresques du Haut Moyen Âge. Des peintures carolingiennes et romanes en ornent les murs et les absides, dépeignant en images l’histoire du salut chrétien. Celles-ci racontent la vie du Roi David, issue de l’Ancien Testament, l’enfance de Jésus, son œuvre et sa mort sur la croix, ainsi que l’Ascension et le retour du Christ à la fin des temps. Les absides sont dédiées aux martyres de Jean-Baptiste et de saint Etienne, ainsi qu’aux apôtres Pierre et Paul. Apprendre à connaître les fresques vieux de 1200 ans dans l'église- Les visites guidées de l’église permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire et l’architecture du couvent, mais aussi de se plonger dans le monde fascinant de ses fresques à l’origine réservées à la méditation de moines lettrés.
Source : https://ourheritage.ch/
Musée
Le musée monastique se situe dans la tour Planta, une tour d’habitation fortifiée plus que millénaire. Accueillis au son d’une cloche liturgique du XIIe siècle, vous serez entraînés dans un voyage au cœur des 1200 ans d’histoire du monastère. Les bénédictines de Müstair vous offrent un aperçu de leurs lieux de vie ainsi que de leur quotidien hier et aujourd’hui.
Visite du musée
La visite du musée débute dans le cloître roman, et se poursuit dans l’imposante cave de la tour Planta puis dans les trois étages supérieurs, qui forment un véritable "monastère dans le monastère". Vous parcourrez des espaces d’habitation et de travail, de modestes cellules comme des lieux d’apparat ou de prière, de même que la chambre "von Hohenbalken", une élégante pièce de réception baroque. Vous découvrirez les dernières trouvailles archéologiques, des objets d’art et d’histoire ainsi que différents trésors issus des collections du monastère.
Visite guidée
A l’origine, l’usage de l’église était réservé à la communauté monastique. Ce n’est qu’au XVIe siècle, suite aux troubles de la Réforme, qu’elle fut ouverte à tous en tant qu’église paroissiale. En été, des offices y ont lieu régulièrement. L’église de Saint-Jean à Müstair abrite le plus grand et le mieux conservé des cycles de fresques du Haut Moyen Âge. Des peintures carolingiennes et romanes en ornent les murs et les absides, dépeignant en images l’histoire du salut chrétien. Celles-ci racontent la vie du Roi David, issue de l’Ancien Testament, l’enfance de Jésus, son œuvre et sa mort sur la croix, ainsi que l’Ascension et le retour du Christ à la fin des temps. Les absides sont dédiées aux martyres de Jean-Baptiste et de saint Etienne, ainsi qu’aux apôtres Pierre et Paul. Apprendre à connaître les fresques vieux de 1200 ans dans l'église- Les visites guidées de l’église permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire et l’architecture du couvent, mais aussi de se plonger dans le monde fascinant de ses fresques à l’origine réservées à la méditation de moines lettrés.
Source : https://ourheritage.ch/
Dernière édition par ADMIN le Lun 18 Sep - 21:13, édité 3 fois

ADMIN
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum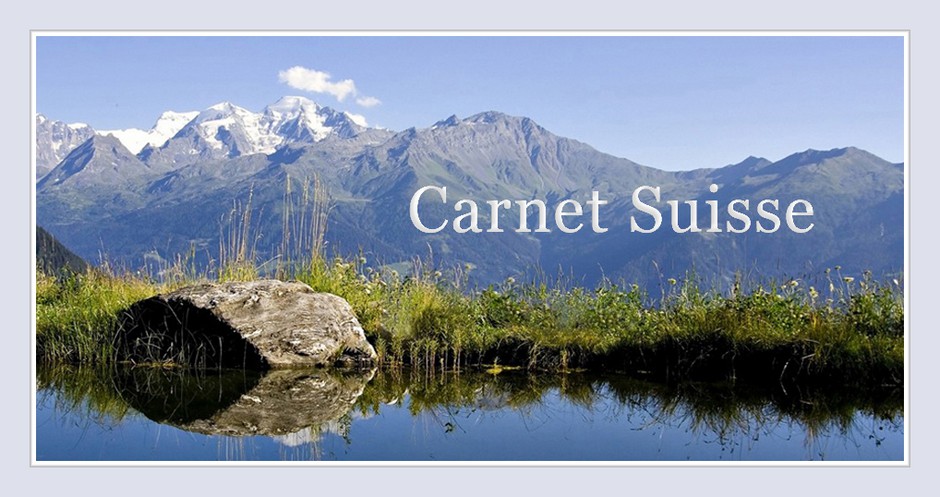
 Accueil
Accueil